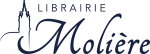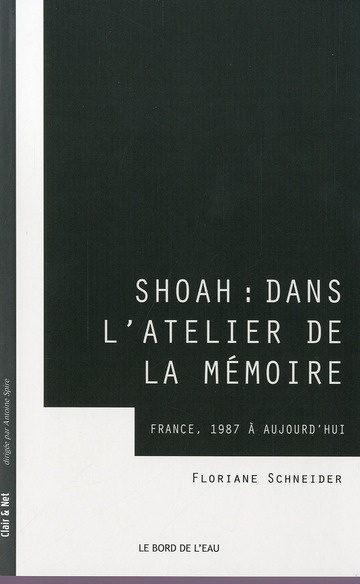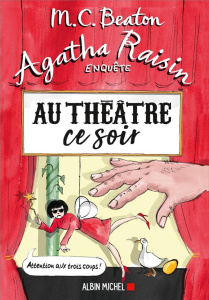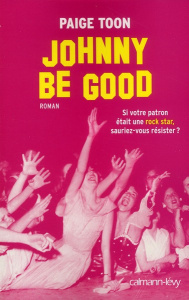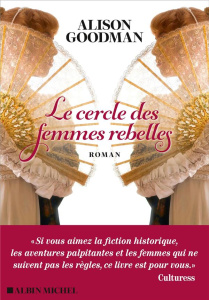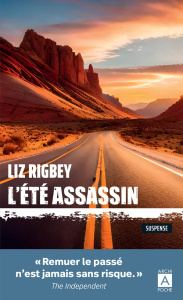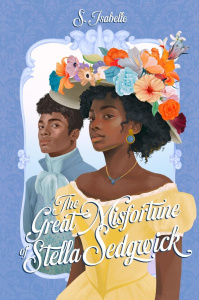Shoah : dans l'atelier de la mémoire. France, 1987 à aujourd'hui
Extrait de l'avant-proposLe 16 juillet 2012, la France s'apprête à commémorer le 70e anniversaire de la rafle du Vel"d'Hiv'. Vingt ans après le décret présidentiel instituant une «journée nationale commémorative des persécutions racistes et antisémites» à la date anniversaire de cette rafle, 42 % des Français déclarent ignorer la signification de l'événement. Selon un sondage réalisé par l'institut CSA pour l'Union des étudiants juifs de France (UEJF), cette proportion est encore plus élevée chez les jeunes: 67 % des 15-17 ans et 60 % des 18-24 ans affirment ne pas savoir ce qui s'est passé les 16 et 17 juillet 1942. Pourtant, depuis plus de vingt ans, «on commémore la Shoah, on en parle, on l'enseigne, on a fait tout ce qui était possible pour inscrire cet événement dans la mémoire nationale». Dès lors, faut-il interpréter ces résultats comme le signe d'un échec? La vague d'inquiétude qu'ils ont soulevée est-elle fondée?Pour l'historien Henry Rousso, «le chiffre de 40 % [des jeunes sachant ce qu'est la rafle] est [...] à [son] sens, plutôt élevé». Il montre à l'évidence que la chaîne de transmission ne s'est pas interrompue. «Après des décennies d'occultations et d'amalgames [...], la mémoire de la Shoah occupe en effet une place inédite. Elle est aujourd'hui institutionnalisée [...] et imprègne la culture de masse.» Tel est le constat établi par Olivier Lalieu et corroboré par d'autres historiens. Depuis la fin des années 1980, la pléthore d'ouvrages historiques, de romans, de films et de débats sur la Shoah apparaît bel et bien comme une émanation de son intensité mémorielle -intensité d'autant plus grande qu'elle a été portée par «la houle de fond de la mémoire». «Ici un peu plus tôt, là un peu plus tard, cette vague de fond, constate François Hartog, a touché pratiquement tous les rivages du monde, sinon tous les milieux.» Si la dynamique mémorielle propre à la Shoah a été abondamment commentée, elle n'a jamais été réellement restituée dans son entière cohérence. Cet ouvrage se propose d'en explorer les mécanismes et les finalités. Comment la mémoire collective de la Shoah s'est-elle forgée? Quels acteurs ont tissé les fils dont sa trame est aujourd'hui composée?La mémoire collective correspond au passé tel qu'un groupe social s'en souvient et/ou se le représente. Sa construction résulte de l'interaction sociale de multiples vecteurs qui modèlent et diffusent des représentations appelées à en devenir constitutives. Les médias et la production culturelle (films, livres, expositions) comptent parmi les vecteurs les plus puissants. Ils alimentent un réservoir d'images et de récits dans lequel la mémoire collective puise abondamment. Il faut également prendre en considération les dispositifs institutionnels - commémorations, musées et mémoriaux, enseignement -, et les diverses initiatives prises par des acteurs agissant ensemble ou isolément dans la société civile. Dans la présente étude, la communauté juive est conçue comme un acteur de la mémoire à part entière. Fédérant une multitude d'associations à vocation cultuelle, culturelle ou sociale, elle est «par essence pluraliste». Dès lors, comment la saisir en tant qu'acteur unique? Créé en 1943 dans la clandestinité, le Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) n'a cessé de gagner en visibilité publique depuis les années 1980. Il a fini par s'imposer comme le porte-parole autorisé de la communauté juive, qui trouve dans les dîners annuels du CRIF, institués en 1985 par Théo Klein, l'occasion de faire entendre une voix unitaire."
20,00 €
Sur commande
EAN
9782356872340
Caractéristiques
| EAN | 9782356872340 |
|---|---|
| Titre | Shoah : dans l'atelier de la mémoire. France, 1987 à aujourd'hui |
| Auteur | Schneider Florence |
| Editeur | BORD DE L EAU |
| Largeur | 130mm |
| Poids | 240gr |
| Date de parution | 23/04/2013 |
| Nombre de pages | 206 |
| Emprunter ce livre | Vente uniquement |