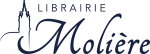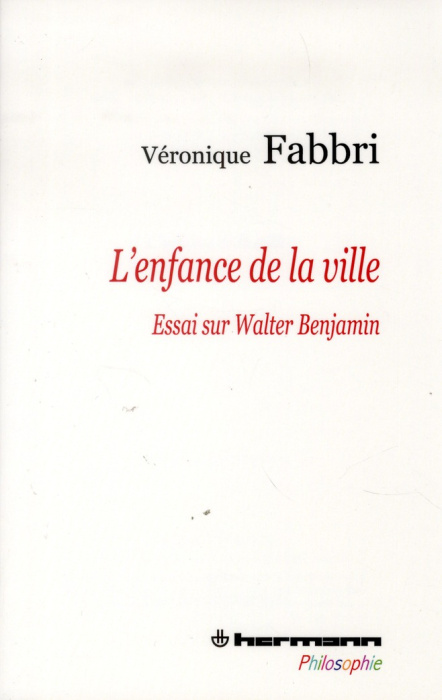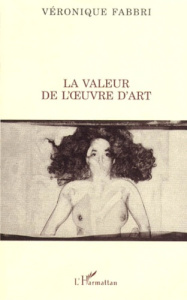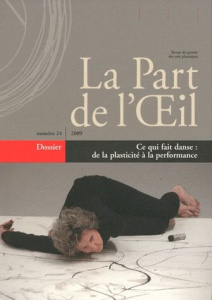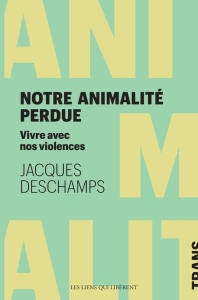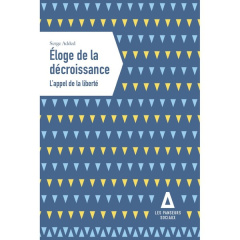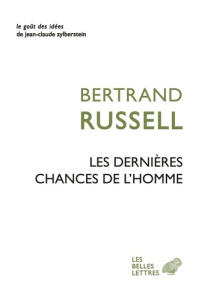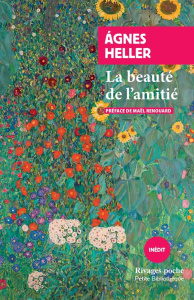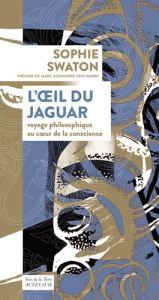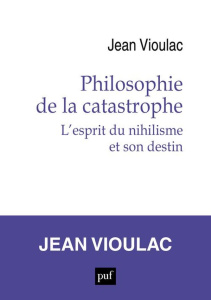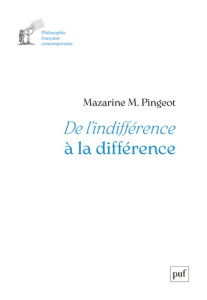L'enfance de la ville. Essai sur Walter Benjamin
Fabbri Véronique
HERMANN
Extrait de l'introduction
Les passages brillaient dans le Paris de l'Empire comme des grottes féeriques. Qui pénétrait en 1817 dans le passage des Panoramas entendait d'un côté, les chants de sirènes de l'éclairage au gaz et avait devant lui les séduisantes odalisques des lampes à huile. En s'allumant brusquement, les lumières électriques rirent pâlir l'éclat irréprochable de ces galeries, qui devenaient soudain plus difficiles à trouver, qui pratiquaient une magie noire avec les portes et contemplaient leur intérieur par des fenêtres aveugles. Ce n'était pas un déclin mais le renversement. Ces passages devenaient d'un coup le moule en creux qui servit à tondre l'image de la «modernité». Le siècle considérait ici avec arrogance le reflet de son passé le plus récent. C'était ici la maison des enfants prodiges.
La ville est un espace d'images, ambigu, dont la signification s'inverse et se retourne, comme un gant, sous l'impulsion d'un simple changement de technique d'éclairage. Dans les villes, l'espace d'images est formé d'une architecture qui communique directement avec un fonds mythique ineffaçable, des gravures, des enseignes qui accompagnent la déambulation du flâneur, mais aussi d'une littérature qui produit une mythologie moderne. C'est un espace trouvé, qui entre en résonance avec un imaginaire à la fois collectif et individuel. Un changement d'éclairage suffit à faire basculer ce monde fictif et égarant dans son contraire. Mais on ne fait que passer d'une mythologie à une autre, qui se pare des attraits de la modernité. Dans l'extrait cité, rien ne dit que le nouveau visage des passages soit plus vrai que l'ancien, bien que des historiens comme Giedion partagent ce sentiment que les passages furent la préfiguration de la modernité.
Dans ce renversement toutefois s'ouvre un espace de jeu (Spielraum), qui n'est plus un ensemble d'images. Plus précisément, ce qui transparaît à travers les images, c'est l'espace lui-même comme le milieu dans lequel elles peuvent prendre un visage et en changer: il n'y a d'image que par le renvoi d'une image à une autre, chaque image prenant son sens dans le système qu'elles forment. C'est là sans aucun doute le lien le plus étroit que l'on puisse tisser entre les recherches de Benjamin et la théorie critique de la société spectaculaire marchande. Le spectacle n'est pas l'image, mais la totalité systématique qu'elles forment.
Toutefois, ce qui intéresse Benjamin, plus que Debord, c'est l'espace de jeu entendu comme renversement d'un système à un autre. C'est alors l'espace lui-même qui se donne à percevoir par la disparition d'images devenues instables. Dans les passages parisiens, ce sont les miroirs qui ont le dernier mot: en un sens ils reflètent fidèlement l'apparence de chacun et, si les femmes sont à Paris plus belles qu'ailleurs, suggère Benjamin, c'est sûrement qu'elles ont dix fois par jour l'occasion d'ajuster cette apparence dans les miroirs qui jalonnent leur parcours. Mais il arrive que ces miroirs jouent aux images un tour pendable: «Si deux glaces se reflètent l'une l'autre, Satan joue son tour préféré et ouvre ainsi à sa manière (comme son partenaire dans le regard des amants) la perspective à l'infini». L'image démultipliée perd sa consistance et l'espace perçu se dépouille des coordonnées qui orientent le corps et la perception ordinaire.
(...)

| EAN | 9782705684082 |
|---|---|
| Titre | L'enfance de la ville. Essai sur Walter Benjamin |
| Auteur | Fabbri Véronique |
| Editeur | HERMANN |
| Largeur | 140mm |
| Poids | 344gr |
| Date de parution | 11/01/2013 |
| Nombre de pages | 268 |
| Emprunter ce livre | Vente uniquement |
Autres livres par l'auteur de " L'enfance de la ville. Essai sur Walter Benjamin " (Fabbri Véronique)
-
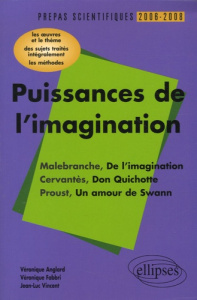 Anglard Véronique ; Fabbri Véronique ; Vincent JeaPuissances de l'imagination Malebranche-Cervantès-Proust. L'épreuve de français Conseils pratiques/C18,50 €
Anglard Véronique ; Fabbri Véronique ; Vincent JeaPuissances de l'imagination Malebranche-Cervantès-Proust. L'épreuve de français Conseils pratiques/C18,50 € -

-

Dans la même catégorie ( 21e Siècle )
-
-
-
Swaton Sophie ; Oho Bambe Marc AlexandreL'oeil du jaguar. Voyage philosophique au coeur de la conscience23,00 €
- Commande avant 16h : Demain dans la boîte aux lettres ! (bpost)
- Livraison dès 5,10 € (mondial-relay)
- Retrait gratuit
- Paiement 100% sécurisé
4,6/5 - ⭐⭐⭐⭐⭐
2448 Avis - Source Google