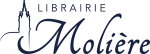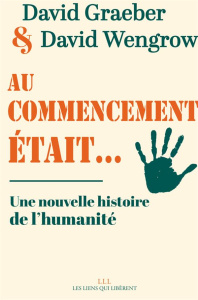Au commencement était...
Répondant entre autres au célèbre « Sapiens : Une brève histoire de l’humanité » de Yuval Noah Harari (Albin Michel), les auteurs – David Graeber, auteur de « Bullshit jobs » et David Wengrow, archéologue - démontrent comment les découvertes archéologiques des trente dernières années permettent d’écrire une autre histoire de l’Humanité.
Comprendre l’Histoire à long terme, c’est aussi tenter de comprendre comment on en est arrivé à vivre dans des sociétés régies par la domination et les inégalités. Nos auteurs dégagent deux axes de réflexion qui orientent presque toujours le débat sur l’histoire de l’humanité : soit on se rallie à l’idée de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) selon laquelle les hommes sont bons par nature, soit à celle de Thomas Hobbes (1588 – 1679) qui au contraire affirmait que l’homme est naturellement violent mais qu’heureusement la vie en société, les lois et la morale lui ont permis de réguler ses pulsions. Dans « Sapiens », Harari semble effectivement plutôt proche de la pensée rousseauiste : selon lui, les hommes vivaient relativement heureux à la Préhistoire, dans des petits groupes isolés où chacun se connaissait, jusqu’à l’invention de l’agriculture il y a 12000 ans, qui serait finalement peut-être la plus grosse erreur de l’histoire de l’humanité. En plus d’appauvrir la diversité de l’alimentation, l’agriculture a donné lieu à l’appropriation d’un territoire, de biens constitués de surplus de production. Ce surplus oblige aussi à s’organiser autrement, à se rappeler qui produit quoi, où on stocke quoi, et pour se souvenir de toutes ces informations nous avons fait nos premiers pas vers l’écriture. En rassemblant des populations de plus en plus denses, il a fallu diviser le travail, partager les tâches, hiérarchiser la société. Les plus puissants sont ceux qui tirent profit du surplus (par l’impôt par exemple). Pour protéger les biens et les territoires les plus fertiles, on assiste à la naissance des guerres territoriales. Et surtout, comme on est plus nombreux, on ne peut plus connaître chaque membre de la société personnellement, et afin de créer des liens avec des inconnus, il faut qu’un symbole ou une histoire nous rassemble : ainsi naissent les mythes, les Etats, les religions. Le début de l’agriculture serait donc aussi le début d’une société inégale, avec des dirigeants et des dirigés, qui finalement travaillent beaucoup plus que les humains de la Préhistoire mais sans être plus heureux.
Les auteurs de « Au commencement était... » pensent qu’il faut dépasser ces deux théories, qui ne permettent pas d’expliquer certaines découvertes archéologiques comme des temples en pierre, des sépultures royales, des monuments en os de mammouths, qui doivent nous faire admettre que nous ne savons rien de ces groupes humains préhistoriques. Prétendre qu’ils vivaient tous de la même manière, qu’ils soient guerriers ou pacifiques, c’est avoir une vision monolithique de l’Histoire. Il y avait peut-être autant d’organisations sociales que de groupes humains, et un même groupe aurait pu avoir plusieurs organisations sociales et politiques en fonction des saisons : quand on observe un site comme celui de Stonehenge par exemple, on peut imaginer un va-et-vient entre dispersion des populations et construction de monuments, ce qui anéantit les efforts pour classer les chasseurs-cueilleurs selon leur niveau de « complexité » - le terme « complexité » se confond d’ailleurs souvent avec « civilisation ».
Rechercher l’origine des inégalités devient une quête anachronique, non seulement parce qu’il est très difficile de définir ce que serait une société égalitaire (égalité en termes de biens, d’accès au savoir, de tâches, …), mais aussi parce que nous ne savons rien de la réalité sociale et politique des sociétés d’avant l’agriculture. Pourtant, d’après les découvertes archéologiques que nos deux auteurs détaillent dans leur ouvrage, nous pourrions penser que durant la Préhistoire, on a eu la liberté de partir s’installer ailleurs, la liberté d’ignorer les ordres donnés ou d’y désobéir, et la liberté de façonner des réalités sociales nouvelles, ou d’alterner entre les unes et les autres. Si l’Humanité a bel et bien fait fausse route à un moment donné de son histoire, c’est sans doute en perdant la liberté d’inventer et de concrétiser d’autres modes d’existence sociale.
p.636 : « Une fois acquises la liberté de partir et la liberté de désobéir […], il ne pouvait exister que des rois de façade, puisqu’il suffisait à leurs sujets de les ignorer ou de déménager s’ils dépassaient les bornes. […] A l’évidence, les sociétés humaines ont bien changé sur ce plan. Nos trois libertés élémentaires n’ont cessé de reculer, et peu de gens aujourd’hui sont capables de se représenter à quoi ressemblerait une société s’articulant autour d’elles. »
La question n’est donc plus tant celle de l’origine des inégalités, mais plutôt celle de la raison pour laquelle nous avons perdu ces trois libertés fondamentales, pour nous laisser enfermer dans une réalité sociale qui a normalisé les rapports fondés sur la violence et la domination.
« Au commencement était... » propose finalement un récit captivant et stimulant de ce que nous ont appris les dernières décennies de recherche scientifique. Nous ne descendons pas d’un paradis perdu, et en prendre conscience permet au moins d’imaginer que d’autres réalités sociales et politiques sont possibles. « Sapiens » est un ouvrage brillant, et il est donc tout à fait naturel qu’il serve de tremplin à de nouvelles interprétations et découvertes. Quand on aime les sciences, on est toujours prêt à remettre en question ce qu’on pensait savoir.
Aurélie, libraire